Le festival Visa pour l’Image, qui rassemble chaque année le monde du photojournalisme, s’est tenu du 1er au 16 septembre à Perpignan. En plus de nombreux colloques et rencontres diverses, il y avait une trentaine d’expositions (ainsi qu’un festival off que je n’ai découvert, sur internet, qu’après mon retour !). Je m’y suis rendu en simple visiteur, et ceci pour la première fois. Je ne suis pas impliqué professionnellement dans le photojournalisme, mais je porte un intérêt soutenu à cette activité et à ses problématiques. En plus des aspects strictement photographiques, c’est tout autant la dimension citoyenne qui me touche. Et sur ce dernier aspect, j’ai été servi : on a rarement l’occasion de voir un tel concentré (quantitatif, géographique, temporel) des misères humaines et des bassesses, tout aussi humaines, qui les causent ! Je précise qu’il ne s’agit pas d’une critique négative et que cela ne doit en aucun cas vous retenir d’y aller l’année prochaine. Bien au contraire.
 La visite des expositions est assez éprouvante pour le moral. Il y a des images très dures et d’autres, quand la violence est visible au premier degré, vraiment insoutenables. Certaines me poursuivront toute ma vie. Mais (au risque de me répéter) il faut absolument continuer à réaliser, diffuser et regarder ces témoignages. Il y a une grande tradition de la photo de guerre en noir/blanc qui, dans certains cas, « adoucit » les brutalités, en particulier la couleur du sang, qui n’a pas le même impact lorsqu’il se présente dans des niveaux de gris plutôt qu’en couleurs. Aujourd’hui, de plus en plus de reporters de guerre adoptent la couleur pour des tas de raisons, ne serait-ce que pour se « mesurer » à la télévision. C’est « de bonne guerre », si j’ose dire ;-) Mais j’ai toujours beaucoup d’admiration pour les photographes qui présentent des reportages en noir/blanc : cela reste pour moi une façon (non exclusive) de porter un regard plus concentré sur l’essentiel, car débarassé de sensationnalisme ou de détails qui détournent l’attention.
La visite des expositions est assez éprouvante pour le moral. Il y a des images très dures et d’autres, quand la violence est visible au premier degré, vraiment insoutenables. Certaines me poursuivront toute ma vie. Mais (au risque de me répéter) il faut absolument continuer à réaliser, diffuser et regarder ces témoignages. Il y a une grande tradition de la photo de guerre en noir/blanc qui, dans certains cas, « adoucit » les brutalités, en particulier la couleur du sang, qui n’a pas le même impact lorsqu’il se présente dans des niveaux de gris plutôt qu’en couleurs. Aujourd’hui, de plus en plus de reporters de guerre adoptent la couleur pour des tas de raisons, ne serait-ce que pour se « mesurer » à la télévision. C’est « de bonne guerre », si j’ose dire ;-) Mais j’ai toujours beaucoup d’admiration pour les photographes qui présentent des reportages en noir/blanc : cela reste pour moi une façon (non exclusive) de porter un regard plus concentré sur l’essentiel, car débarassé de sensationnalisme ou de détails qui détournent l’attention.
Bien plus qu’ailleurs, les photos présentées à Perpignan, sont très dépendantes de leurs légendes. Certaines images, quelques fois sous des dehors paisibles, prennent une dimension vertigineuse après la lecture du texte d’accompagnement. (D’ailleurs, avez-vous déjà essayé de comprendre les images de la rubrique « No Comment » sur Euronews ? Cela peut se révéler un jeu intéressant à pratiquer en famille !) Tout en essayant de ne pas enfoncer des portes ouvertes sur les relations texte/image... je dois dire que j’ai été frappé par le fait qu’à Visa pour l’Image, on passe souvent plus de temps à lire des légendes qu’à voir les photos qui s’y rapportent. Cela a une conséquence : les textes sont tellement prenants qu’on n’a presque plus le loisir de s’attarder sur les propriétés intrinsèques des photos. Même si celles-ci ont de véritables qualités esthétiques, l’information brute qu’elles contribuent à véhiculer mobilise toute l’attention. Cela atténue quelque peu le souci qu’évoquent certains (dont moi-même) que l’esthétisation de photos de guerre ne se fasse au détriment de la détresse qui y est évoquée.
 Mais tout n’est pas tout noir. Il y a heureusement des lueurs d’espoir bienvenues dans ce parcours. Par exemple, pour illustrer ce billet, j’ai trouvé amusant de juxtaposer 2 photos vues à Perpignan : un sujet semblable traité par 2 photographes différents, l’afghan Ahmad Masood et le russe Sergey Maximishin.
Mais tout n’est pas tout noir. Il y a heureusement des lueurs d’espoir bienvenues dans ce parcours. Par exemple, pour illustrer ce billet, j’ai trouvé amusant de juxtaposer 2 photos vues à Perpignan : un sujet semblable traité par 2 photographes différents, l’afghan Ahmad Masood et le russe Sergey Maximishin.
 Je reviendrai prochainement à ces deux-là... Je vous passe les détails des prix qui ont été décernés à Perpignan et qui ont déjà été relatés par de nombreux sites et journaux. Vous en apprendrez plus sur le site officiel de Visa pour l’Image (lien cassé). Mais, ce dernier n’étant pas un modèle d’ergonomie et de navigation, je vous recommande plutôt catacult.net, qui est bien plus convivial et plus complet. (Si non, essayez les moteurs de recherche... vous y retrouverez à des dizaines d’exemplaires, les sites qui copient/collent à la virgule près, tous les communiqués du programme officiel ;-)
Je reviendrai prochainement à ces deux-là... Je vous passe les détails des prix qui ont été décernés à Perpignan et qui ont déjà été relatés par de nombreux sites et journaux. Vous en apprendrez plus sur le site officiel de Visa pour l’Image (lien cassé). Mais, ce dernier n’étant pas un modèle d’ergonomie et de navigation, je vous recommande plutôt catacult.net, qui est bien plus convivial et plus complet. (Si non, essayez les moteurs de recherche... vous y retrouverez à des dizaines d’exemplaires, les sites qui copient/collent à la virgule près, tous les communiqués du programme officiel ;-)
Sur le chemin du retour de Visa pour l’Image à Perpignan (j’y reviendrai), je me suis arrêté aux expos des Rencontres Photographiques d’Arles, qui accueillaient leurs derniers visiteurs.L’agence Magnum, qui fête ses 60 ans, y faisait voir une impressionnante exposition rétrospective. Après la présentation d’un ensemble de panneaux qui mettait l’accent sur les points forts de la chronique de l’agence, on invitait le visiteur à choisir, en vidéo interactive, une sélection de photos de chacun des 80 photographes de l’agence. Ce fut l’occasion, une fois de plus, de prendre la mesure du nombre et de la qualité des « grosses pointures » qui sont, ou qui ont passé, chez Magnum !
Toujours à l’affut de bribes de réponses à mes questionnements au sujet des images (C’est quoi une image ? Où est la vérité ? Est-ce que les images mentent ? ;-), je suis tombé sur quelques citations qui m’ont interpellé. Je vous en présente des reproductions ci-dessous... (c’est moi qui les souligne d’un rectangle blanc)


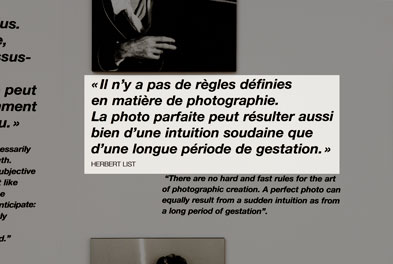


De truismes en vérités bancales, de contradictions poétiques en approximations, nous voilà bien avancés... ;-)
Chers amis de la poésie et du bon goût, voici une image qui va vous combler...
Cet été, j’ai été amené à changer d’application FTP (File Transfer Protocol - Cela sert à envoyer ou retirer des fichiers sur un serveur distant). On dit beaucoup de bien de RBrowser, alors allons-y. Il y a même une version light gratuite, ça aide. Côté fonctionnement du programme : rien à dire, l’informaticien à fait du bon boulot. Pourtant, lorsqu’on télécharge un fichier, voici la jolie petite icône qu’il nous présente, pour le cas où nous voudrions interrompre l’opération...
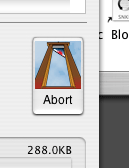 Vous remarquerez le délicat liseré rouge sur la lame. Si votre écran est de bonne qualité, vous verrez aussi que le bas des montants de bois est teinté de rouge. Là, je vois votre imagination galoper... vous vous dites que si on clique sur le bouton pour interrompre le téléchargement on va voir tomber la lame. Vous avez tout juste !
Vous remarquerez le délicat liseré rouge sur la lame. Si votre écran est de bonne qualité, vous verrez aussi que le bas des montants de bois est teinté de rouge. Là, je vois votre imagination galoper... vous vous dites que si on clique sur le bouton pour interrompre le téléchargement on va voir tomber la lame. Vous avez tout juste !
Le terme abort, bien que correct d’un point de vue informatique, n’est déjà pas des plus élégants (le sens premier signifie avorter). On aurait pu, de surcroit, nous épargner la violence de cette icône. Tous les designers savent que, sous des dehors pauvres, les icônes peuvent présenter un contenu sémantique plus large. En général, elles ne font sens que dans un contexte donné et convenu. Leur succès dans les interfaces d’ordinateurs, en tant que raccourcis, est justement dû à cela. (Une représentation d’imprimante = « Je voudrais bien que mon ordinateur demande à mon imprimante d’imprimer cette page »). Si on décide d’enrichir ce concept basique en utilisant des métaphores visuelles plus « ambitieuses », il faut alors, mesurer toute l’étendue du champ sémantique qu’elles recouvrent. Cela demande un certain doigté que ne possède pas le premier informaticien venu, aussi génial soit-il. (Certains sont aussi doués pour la communication visuelle que je le suis moi-même en informatique ;-)
Inculture ? Ignorance ? Infantilisme ? Manque de repères ? Irrespect ? Humour ? Provocation ? Pour moi c’est un peu tout cela à la fois : aujourd’hui on ose. On ose tout.
Soyons plus clairs. Il n’y a pas de sujets tabous et on peut tout dire, tout faire. Mais dans un contexte défini. On ne peut pas poser n’importe où et n’importe comment, un symbole aussi connoté qu’une guillotine, alors que 69 pays dans le monde, à commencer par les plus grands (Chine, Etats-Unis) maintiennent encore la peine de mort.
Chiffres et arguments ici :
Wikipedia, Amnesty international, Coalition mondiale contre la peine de mort. (Je ne mets pas de lien vers ce logiciel. Vous le trouverez facilement si le coeur vous en dit.)
Willy Ronis photographie son épouse, Marie-Anne, dans leur petite maison de Gordes, en 1949. Cette photo, bien que n’étant pas du tout représentative de l’ensemble de l’œuvre du photographe, fera le tour du monde. Elle a figuré dans l’exposition The Family of Man et on la trouve toujours sous forme de poster.

Cette image d’une pudeur délicate nous imprègne d’un bonheur simple et doux. Il va faire chaud. Plus tard on fermera le volet pour préserver un peu de fraîcheur. Et nous, on s’en va sur la pointe des pieds... on ne rompt pas ce charme.
Willy Ronis nait en 1910, à Paris, de parents russes immigrés. Bien que se destinant à la musique, il photographie depuis l’âge de 15 ans, encouragé par son père qui tient une boutique de photos. Il travaille dans l’entreprise familiale, mais cela ne le passionne guère. Après la mort de son père, il décide de photographier ce qu’il aime : la vie des gens, surtout celle des plus modestes. Le cœur à gauche, il suit les manifestations populaires et les luttes qui agitent la classe ouvrière (Front Populaire). Son regard poétique se porte sur la vie des rues, les ambiances de bistrot ou les jeux d’enfants. Cela lui vaudra, plus tard, d’être reconnu parmi les grands représentants de la photographie humaniste, à l’instar des Doisneau, Boubat, Izis, Brassaï... En 1947, il entre à l’agence Rapho. Il en sort après 15 ans sur un différent concernant la maitrise de ses légendes : il ne supportait pas que ses photos soient détournées de leur contexte original. Le même type de problème surgit après quelques collaborations avec Life : il ne travaillera plus pour Life. Dur d’être intègre ! Il publie beaucoup et des expositions prestigieuses lui sont consacrées jusque dans les années 60. Les générations montantes et de grands changements sociaux le font un peu oublier. En 1972, il quitte Paris et s’installe dans le Midi, pour vivre autrement.
Mais on ne l’oublie pas longtemps. Dès 1975 on le relance et il répond à toutes les sollicitations avec une gentilesse proverbiale. Pour autant, « la vie ne l’a pas épargné » ! En 1988, son fils Vincent se tue en deltaplane. En 1991, son épouse Marie-Anne le quitte, victime de la maladie d’Alzheimer. Perturbé par l’accident de son fils, il décide, à l’âge de 84 ans, de faire un saut en chute libre. Cela le porte à pratiquer le parachutisme et le parapente jusqu’à 90 ans ! Ce n’est qu’en 2001 (il a 91 ans) qu’il a posé ses appareils de photo. En 2006, la ville de Paris, (où il vit de nouveau) lui consacra une grande exposition rétrospective.
Toutes sortes de reproductions de cette photo, souvent de qualité discutable, se baladent sur internet. J’ai choisi de « citer » celle de Pierre-Jean Amar, qui me semble la meilleure. Et pour cause : il est le « tireur » attitré de Wily Ronis.
Pour rédiger ce billet je me suis inspiré, entre autres, des sources suivantes :
![]() Photophiles Magazine - N°59 - Willy Ronis, par Eric Janvier
Photophiles Magazine - N°59 - Willy Ronis, par Eric Janvier
![]() Dossier préparé par Virginie Chardin, à l’occasion de la grande exposition consacrée à Willy Ronis par la ville de Paris en 2006. (Il y a plusieurs pages - Sommaire au bas de la page)
Dossier préparé par Virginie Chardin, à l’occasion de la grande exposition consacrée à Willy Ronis par la ville de Paris en 2006. (Il y a plusieurs pages - Sommaire au bas de la page)
![]() Interview de Willy Ronis, par Carole Condat, dans US MAG (publication du SNES) - No 649 - Pages 44 et 45. Attention : .pdf (5,9Mo)
Interview de Willy Ronis, par Carole Condat, dans US MAG (publication du SNES) - No 649 - Pages 44 et 45. Attention : .pdf (5,9Mo)
Rubrique: Les grands classiques
Les images paisibles d’enfants heureux sont légion. Il en est malheureusement beaucoup d’autres, mettant en scène des enfants victimes des pires atrocités. Celle de Kim Phuc, la petite Vietnamienne de 9 ans, est probablement celle qui a le plus fortement et le plus durablement marqué les mémoires.
 Le 8 juin 1972, le photographe Nick Ut est sur la route menant au village de Tran Bang, tenu depuis 3 jours par les troupes du Nord-Vietnam et assiégé par les Sud-Vietnamiens. La plupart des habitants du village ont déjà fui les lieux et se tiennent sur la route, à quelques kilomètres, dans l’espoir de retourner chez eux après la fin des combats. Alors que tout indiquait qu’il n’y avait plus un Nord-Vietnamien dans le village, l’armée sud-vietnamienne décide néanmoins de bombarder le village au napalm. Sur la route, aux avant-postes, se tient une petite armada de soldats, de photographes, cameramen et autres journalistes, tous dans l’attente du « spectacle » annoncé... (Qui a vu le film Apocalypse Now peut effectivement parler de « spectacle », même si cette désignation est terriblement ambigüe - c’est d’ailleurs une des clés du film, mais je m’égare !)
Le 8 juin 1972, le photographe Nick Ut est sur la route menant au village de Tran Bang, tenu depuis 3 jours par les troupes du Nord-Vietnam et assiégé par les Sud-Vietnamiens. La plupart des habitants du village ont déjà fui les lieux et se tiennent sur la route, à quelques kilomètres, dans l’espoir de retourner chez eux après la fin des combats. Alors que tout indiquait qu’il n’y avait plus un Nord-Vietnamien dans le village, l’armée sud-vietnamienne décide néanmoins de bombarder le village au napalm. Sur la route, aux avant-postes, se tient une petite armada de soldats, de photographes, cameramen et autres journalistes, tous dans l’attente du « spectacle » annoncé... (Qui a vu le film Apocalypse Now peut effectivement parler de « spectacle », même si cette désignation est terriblement ambigüe - c’est d’ailleurs une des clés du film, mais je m’égare !)
Sitôt après l’attaque, ces témoins « privilégiés » voient s’échapper et courir vers eux des rescapés, pour la plupart grièvement brûlés. Kim Phuc, la petite fille, est nue car elle s’est débarrassée de ses vêtements en feu. Tous crient atrocement. Après avoir dépassé les témoins, ils s’arrêtent enfin. Certains tentent maladroitement de leur venir en aide. Nick Ut, parlant le vietnamien, est le seul journaliste à pouvoir communiquer avec eux. Avec son chauffeur, dans son minibus maintenant bondé, il transporte Kim et des membres de sa famille vers un hôpital – à une heure de route – et insistera personnellement auprès du personnel médical pour que la petite soit prise en charge. (En temps de guerre, les hôpitaux, débordés, privilégient les soins aux personnes qui ont le plus de chances de s’en sortir. Et Kim ne faisait sans doute pas partie de cette catégorie.) Dans cet article (en anglais), Nick Ut se souvient de cette journée...
Kim Phuc, après 14 mois de soins et 17 opérations chirurgicales, s’en est sorti. Elle vit maintenant au Canada avec ses 2 enfants. Elle a été nommée Ambassadrice de Bonne Volonté (Goodwill Ambassador) de l’UNESCO en 1997. Nick Ut n’avait jamais raconté qu’il avait sauvé cette petite fille. Ce n’est que 28 ans plus tard que Kim Phuc, devant la reine d’Angleterre, a rapporté qu’il lui avait sauvé la vie.
La photo ne paraitra que le 12 juin dans le New York Times. Sa parution ne fut pas retardée par des problèmes techniques (on disposait déjà de moyens de transmission, à l’époque). Cela peut nous paraître surréaliste aujourd’hui, mais de très vives discussions se sont engagées entre rédacteurs pour savoir si on avait le droit de publier la photo d’une personne nue ! Finalement, entrevoyant tout de même l’importance de cette photo, il fut décidé de la publier, non sans obtenir la garantie de ne pas en faire un agrandissement. Il paraîtrait même que l’on a flouté légèrement la région pubienne de la petite fille.
Cette image a eu un grand impact et a prétendument permis d’accélérer la fin de la guerre du Vietnam. Il faut relativiser son importance dans ce cadre, ne serait-ce que parce qu’elle arrive à un moment où la fin de la guerre est en vue. Mais sa très grande force iconique vient de sa propagation. Elle a été utilisée, récupérée et décontextualisée par d’innombrables mouvements idéologiques, politiques ou religieux. Et ceci, dans les projets éditoriaux les plus divers. (Dans ce registre, Le Cri d’Edward Munch, n’a qu’à bien se tenir !) Ronald N. Timberlake, est un vétéran de la guerre du Vietnam et s’insurge de certaines dérives dans un texte largement diffusé sur internet : The Myth Of The Girl In The Photo.
La photo en haut de ce billet représente le cadrage de sa parution dans le NY Times. Très forte, dramatique et bien centrée sur le sujet. Mais on peut trouver d’autres cadrages, ainsi que d’autres photos de la scène qui racontent autant d’autres histoires. Par exemple, si on élargit le cadre, on voit à droite un photographe.
 Il s’agit de David Burnett, qui un instant plus tard, a saisi cette image :
Il s’agit de David Burnett, qui un instant plus tard, a saisi cette image :
 D’autres images encore, font voir l’armada de journalistes dont je parlais plus haut et pourraient raconter l’histoire d’une petite fille qui serait victime de l’acharnement de la presse et de sa passivité face à ses souffrances. (C’est le statut des photographes de guerre qui est en question ici. N’ayant jamais entendu siffler une balle ailleurs qu’au cinéma, je me garderai bien de donner une quelconque leçon...)
Gerhard Paul, nous parle de cela et de bien d’autres aspects de cette image dans un essai passionnant sur l’authenticité, l’icônisation et la surmédiatisation d’une image de la guerre. Dans son article (en allemand) vous trouverez également tout un appareil de références, ainsi que certaines images pour le moins étonnantes.
Nick Ut (de son vrai nom Huynh Cong Ut) est né en 1951 au Vietnam. À 16 ans il entre à l’agence Associated Press. Son frère ainé, Huynh Thanh My, photographe chez AP aussi, vient d’être tué. Il réside et travaille aujourd’hui à Los Angeles, toujours pour Associated Press. Le Prix Pulitzer lui a été remis pour cette photo en 1973. Aujourd’hui, 35 ans plus tard, il est célébré pour la photo pipole d’une richissime bécasse délurée... Il faut bien vivre ! Je dis cela sans mépris pour le photographe, car je comprends bien qu’on ne puisse pratiquer la photo de guerre pendant toute une vie. Mais je ne peux m’empêcher de me demander... : le raccourci saisissant entre ces 2 photos, à 35 ans de distance, nous donnerait-il la mesure du changement de nos exigences en matière de photo de presse ? Je ne veux pas le croire...
D’autres images encore, font voir l’armada de journalistes dont je parlais plus haut et pourraient raconter l’histoire d’une petite fille qui serait victime de l’acharnement de la presse et de sa passivité face à ses souffrances. (C’est le statut des photographes de guerre qui est en question ici. N’ayant jamais entendu siffler une balle ailleurs qu’au cinéma, je me garderai bien de donner une quelconque leçon...)
Gerhard Paul, nous parle de cela et de bien d’autres aspects de cette image dans un essai passionnant sur l’authenticité, l’icônisation et la surmédiatisation d’une image de la guerre. Dans son article (en allemand) vous trouverez également tout un appareil de références, ainsi que certaines images pour le moins étonnantes.
Nick Ut (de son vrai nom Huynh Cong Ut) est né en 1951 au Vietnam. À 16 ans il entre à l’agence Associated Press. Son frère ainé, Huynh Thanh My, photographe chez AP aussi, vient d’être tué. Il réside et travaille aujourd’hui à Los Angeles, toujours pour Associated Press. Le Prix Pulitzer lui a été remis pour cette photo en 1973. Aujourd’hui, 35 ans plus tard, il est célébré pour la photo pipole d’une richissime bécasse délurée... Il faut bien vivre ! Je dis cela sans mépris pour le photographe, car je comprends bien qu’on ne puisse pratiquer la photo de guerre pendant toute une vie. Mais je ne peux m’empêcher de me demander... : le raccourci saisissant entre ces 2 photos, à 35 ans de distance, nous donnerait-il la mesure du changement de nos exigences en matière de photo de presse ? Je ne veux pas le croire...